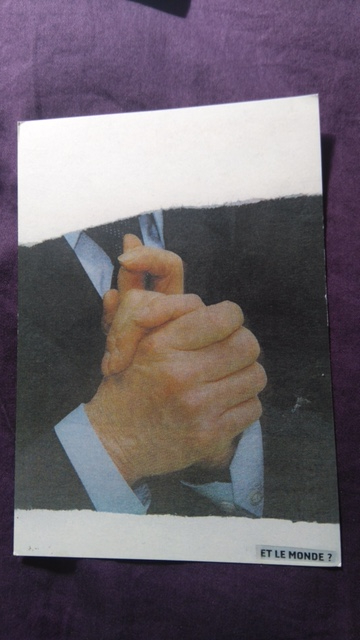Lambeaux de caoutchouc

Faire la route à vélo est un voyage près du bitume. On a le temps de détailler chaque nid-de-poule creusé par les intempéries, de faire le compte des innombrables lambeaux de plastique et de gomme qui jonchent les bas-côtés : les poids-lourds et les pic-up passent en trombe et dispersent négligemment des débris d'eux-mêmes. Chaque fois, ces lanières noires et zigzagantes me font tressaillir, je crois y deviner un serpent que j'évite en m'agrippant au guidon. Kilomètre par kilomètre, nos sens se fixent sur l'asphalte – un autre simili-serpent, fais bien attention – puis, encore et encore – retiens ta respiration le plus longtemps possible – l'odeur de charogne des animaux morts, écrasés.
Ce n'est peut-être pas très joyeux comme sujet, mais ça me prend aux tripes chaque fois, ça sent très fort. Impossible de voyager à vélo sans composer quotidiennement avec l'odeur et la vision de cette foultitude de cadavres. Pour domestiquer mon dégoût, j'ouvre une double page dans un cahier, que j'intitule la «page des morts». Les nommer, leur rendre hommage, leur rendre leur beauté, les montrer à celles et ceux que je croiserai. Je les dessine, je leur emprunte une ou deux plumes et, quand ils sont assez petits et assez secs, les colle tout entier sous des carrés de plastique récupérés.
Les enfants surtout, aiment cette page. Assises sur une marche, nous les regardons, Flora, Gisela et moi, non par curiosité morbide mais simplement admiratives et désolées. Les deux gamines caressent les plumes, approchent leurs doigts de la grenouille minuscule, me font réciter la liste de mes découvertes, la liste des morts que nous avons croisés : perruches, chats, chiens, serpents, mais oui des vrais, un tatou, des papillons, quelques grenouilles, des scarabées, une vache, un cheval encore à l'agonie, des rats, des lapins, d'autres oiseaux – je ne connais pas leur nom –, les 8'000 têtes de bétail par jour à l'Anglo de Fray Bentos, les charruas dans leur quasi- intégralité et tous les peuples indigènes que je ne sais pas nommer, les prisonniers argentins balancés dans la mer depuis des avions sous les yeux impassibles de Montevideo, Hugo Chavez et puis le Pape. «¿El papa? ¿Está muerto? – Non, je ne sais pas, je crois... il paraît qu'il y a un nouveau Pape... – C'est donc qu'il doit être mort, non ? – De toutes façons, on s'en fiche, pour ce que ça change !».
Le pape n'est pas mort : nous n'avons pas compris ce que racontaient les journaux. Nous avons seulement subi l’effervescence de la capitale argentine. Ensuite, l'indifférence rencontrée en Uruguay ne nous a pas aidés à y voir clair. Ici, peu de lieux de cultes visibles. Peu de signes religieux, peu de cimetières ou de traces de rites funéraires. L’Église et l’État sont séparés depuis près d'un siècle. Aucune ferveur religieuse sur notre chemin et des droits progressistes assez précoces dans l'histoire du pays, concernant le droit de vote des femmes, le divorce ou encore le mariage homosexuel. À Melo deux semaines plus tôt, Ramón le médecin réactionnaire nous avait confié «En 1988, j'ai été réquisitionné, au cas où, quand Jean-Paul II est passé chez nous. Mais ça a été un fiasco complet : 6'000 visiteurs au lieu des 50'000 escomptés. Les Uruguayens se foutent bien de la religion ! Si le Pape vient chez nous, ce ne sera pas pour évangéliser mais bien pour des questions politiques !». Ramón est fier et honoré d'avoir été spécialement chargé de la santé du Pape, mais il rit bien de l'impiété locale.
Le film El baño del Papa (Les toilettes du Pape), réalisé en 2008 par deux Uruguayens, Enrique Fernández et César Charlone, vous donnera une autre version de l'histoire, pas bien plus bigote, mais autrement plus triste. Ma propre impiété m'enjoint à conserver la Pape dans la longue liste des morts de ce voyage, tandis que nous quittons la meurtrière ruta tres pour des camions sin pavimiento moins fréquentés. Ces routes de terre, malheureusement très mal référencées sur nos cartes et barrées de barbelés propriétaires, sont pourtant plus clémentes aux voyageuses de toute espèce non motorisées. De quoi interrompre pour ce soir ma chronique des chiens écrasés.
- Catégorie parente: Rubriques spéciales
- Affichages : 13723