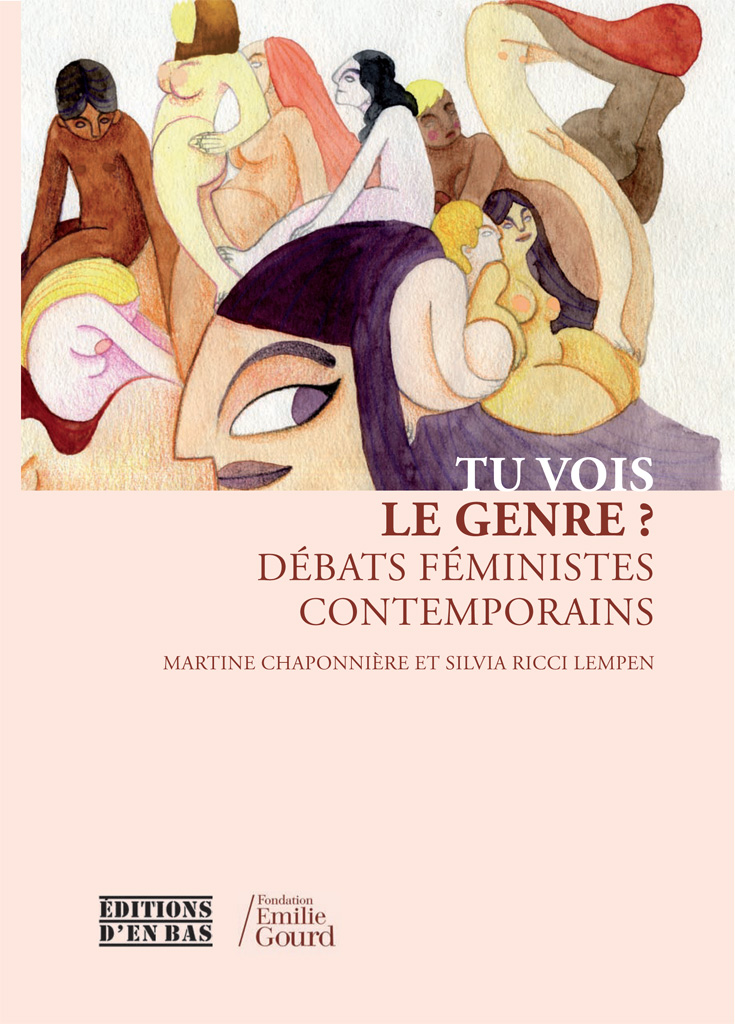Après le printemps érable ?

Suite à l’expression de leur indignation, les universitairesquébécois-e-s sont retourné-e-s à leurs études. Certaines, comme Line Chamberland, pointent à l’avant-garde. Rencontre avec cette chercheuse et militante féministe – professeure au département de sexologie (UQAM) et membre du Réseau québécois en études féministes (RéQEF) – qui a fait de la conciliation un outil de prédilection.
Quels sont les enjeux actuels du féminisme dans le contexte québécois ?
Actuellement, le mouvement féministe est sur la défensive parce qu’il y a un gouvernement conservateur au niveau fédéral. La question de l’avortement revient de façon indirecte à travers des débats sur le statut légal du fœtus et c’est une menace qui vise à remettre en question les lois sur l’interruption de grossesse. Le gouvernement conservateur au pouvoir est anti-féministe, anti-homo, anti-environnementaliste, donc il coupe ces subventions. Par exemple, la Fédération des femmes du Québec, qui est la coalition de plusieurs organismes féministes, a vu son budget diminué d’une part substantielle, ce qui affaiblit les organisations et rend plus facile d’attaquer les acquis féministes.
Qu’en est-il justement de ces acquis ?
Des batailles ont été remportées sur l’équité en emploi, toutefois les écarts salariaux demeurent importants et l’égalité sur le plan du travail, notamment l’accès à divers types d’emplois, n’est pas acquise. Le temps partiel, les situations précaires sont toujours davantage le lot des femmes et c’est souvent lié au partage des tâches domestiques. Il y a d’ailleurs un vaste programme au Québec concernant les garderies à peu de frais afin de promouvoir des conditions qui facilitent le travail des mères. Un autre problème au Québec renvoie au mouvement masculiniste, anti-féministe. Il y a toujours eu des ressacs, mais là il s’agit d’un mouvement organisé. Cette période est difficile et nous avons affaire à un plafonnement des gains notamment à travers la vision néolibérale qui force les mouvements à se rabattre sur les acquis et enlève des moyens qui permettraient d’avoir une force de proposition.
Quelles sont les questions vives qui se posent au sein de ces mouvements ?
La question intergénérationnelle et une interrogation sur le «nous femmes» et la diversité sont particulièrement saillantes. Cet écart entre générations, où beaucoup de jeunes disent que c’est acquis maintenant, pose la question de comment intéresser et mobiliser les jeunes femmes. Donc la Fédération des femmes du Québec a fait un travail de soutien d’un congrès pour les jeunes féministes et une certaine relève est en train d’émerger. Il est nécessaire de la soutenir.
Un autre enjeu est celui de l’intégration des femmes des communautés ethnoculturelles. Chez nous, le terme communauté est très employé, mais on s’aperçoit que le mouvement des femmes a beaucoup de difficulté à l’intégrer non seulement dans la liste des revendications, mais aussi dans les équipes de travail. Le danger consiste à ne pas reproduire les rapports d’inégalité et d’exclusion, par exemple par rapport aux femmes handicapées, migrantes, et il s’agit donc de leur permettre d’accéder à un pouvoir d’agir aussi au sein des mouvements féministes. Des états généraux sont justement à l’ordre du jour.
Quels sont à vos yeux les messages fondamentaux à transmettre ?
Il est nécessaire de faire attention aux divisons pour qu’elles ne se creusent pas, pour qu’elles ne deviennent pas des fractures. Des luttes de longue date ont donné des gains qui sont en train de s’épuiser et il faut reprendre les luttes d’une autre façon. Plutôt que de discréditer ces femmes et leurs luttes, il faut voir quelle était leur situation et les enjeux de l’époque. Il peut bien sûr y avoir des désaccords mais il ne faudrait surtout pas tomber dans le mépris.
De quelle façon vivez-vous votre engagement féministe ?
Je suis davantage une personne de conciliation que de confrontation. Ça a été ma façon de m’insérer dans le féminisme, dans mon syndicat. J’essayais de réaliser des rapprochements. J’étais tiraillée en moi, par exemple sur les tensions concernant la reproduction de l’hétéronormativité d’une part et la mouvance queer d’autre part : est-ce qu’on est en train de s’assimiler, de se conformer aux normes dominantes ? Mais en même temps les lois ne sont-elles pas nécessaires et susceptibles de changer le quotidien ? Je peux vivre ces déchirements dans mon for intérieur, exprimer des opinions politiques, mais je ne veux pas en faire des lignes de fracture, des clashs. Je suis pour l’écoute mutuelle. Je m’efforce de rassembler plutôt que de diviser.
Est-ce le fil rouge de votre démarche ?
Le fil conducteur de mon travail militant et de mes recherches se tisse autour des questions d’intégration et de marginalisation liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, autour du respect des droits dans des contextes institutionnels. Je me suis centrée sur le milieu de travail, le contexte scolaire ainsi que sur les services sociaux et de santé. Les questions identitaires sont toujours présentes mais l’idée principale renvoie aux contextes institutionnels dans le sens où le changement passe par des lois, mais pas uniquement par elles. Il est nécessaire de transformer les pratiques institutionnelles. En effet, il y a des discours en faveur de l’égalité, mais concrètement la question se pose de ce qui est mis en place pour créer des milieux vraiment ouverts aux différents formes de diversité.
Quels objectifs désirez-vous atteindre concernant les discriminations dans ces contextes institutionnels ?
L’objectif est d’identifier et de documenter, une fois que l’égalité des droits est établie, les situations de discriminations mais aussi les craintes des personnes dans leur milieu professionnel ou face au système médical. Cela permet de construire des outils adaptés et de développer des sessions de formation pour les professionnel-le-s de l’éducation, de la santé et des ressources humaines.
Quels sont vos principaux constats ?
La marginalisation des lesbiennes et la difficulté d’inclure les dimensions trans* alors que les questions de genre sont incontournables. J’essaie de les amener autant dans le champ associatif qu’universitaire, de les ouvrir et créer des échanges. Je me définis donc comme une alliée des trans* dans les mouvances féministes et je demeure féministe, d’un féminisme pluriel dont la lutte continue à être fondamentale.
Photo © Joanna Osbert