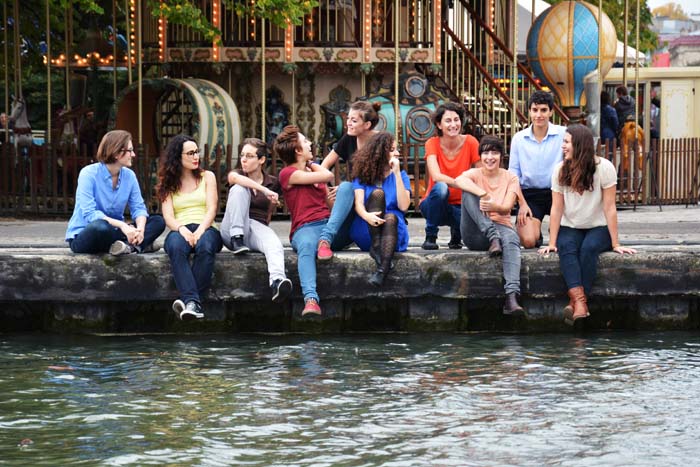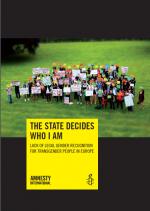Le genre n'est pas une théorie
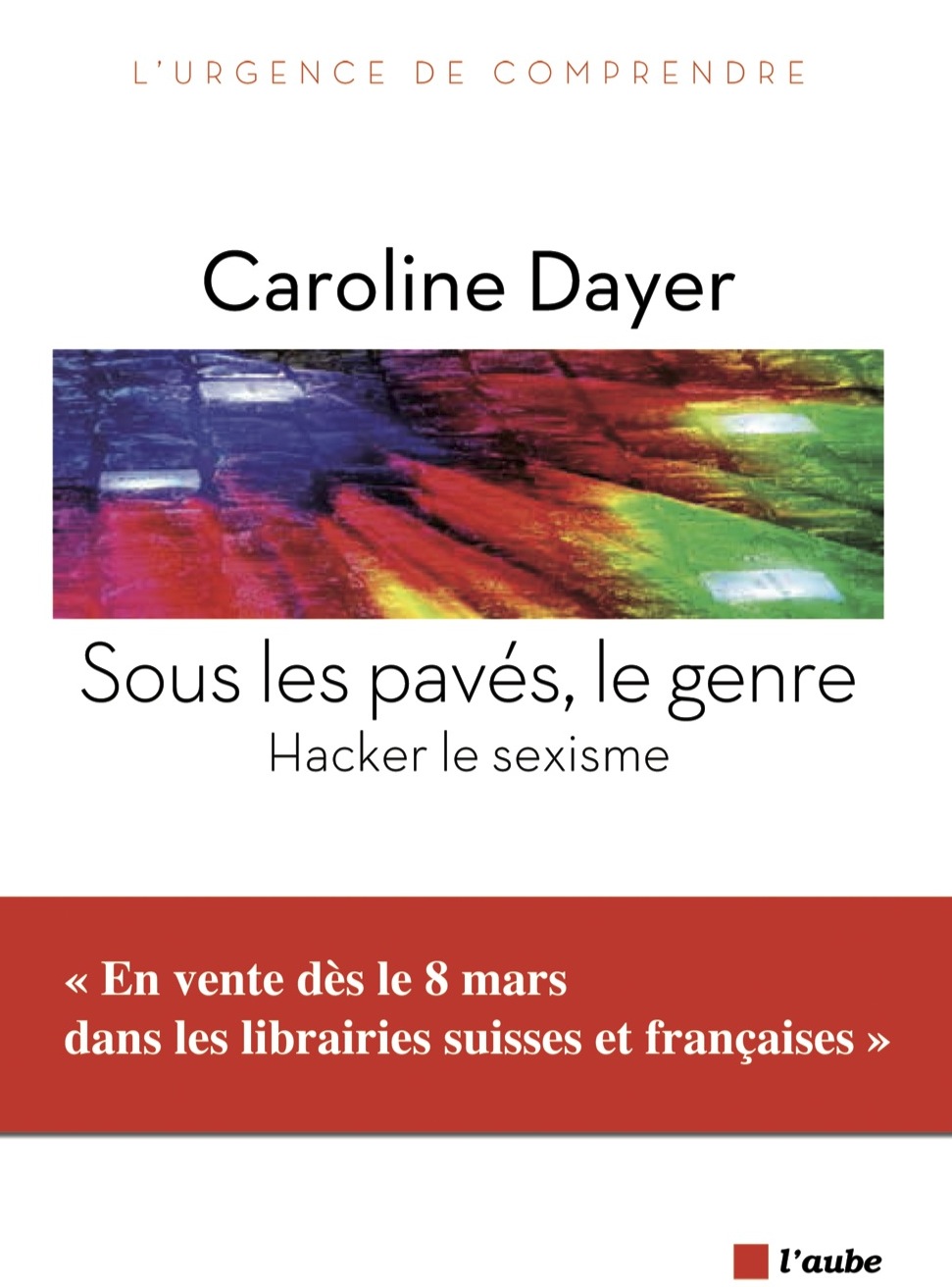
Alors que les réactionnaires de tous poils combattent sauvagement l'égalité et la "théorie du genre", Caroline Dayer, enseignante et chercheuse à l'Université de Genève publie un livre intitulé Sous les pavés, le genre. Hacker le sexisme qui bat en brèche les mécanismes qui sous-tendent ces mouvements. Interview.
l'émiliE: Vous publiez votre ouvrage Sous les pavés, le genre. Hacker le sexisme, est-ce en réponse à la Manif pour tous et à d’autres frondes anti-genre en France ?
Caroline Dayer: Fouler les pavés contre l’égalité… Ces récentes manifestations m’ont effectivement fait cheminer vers ce titre. Par contre, le projet de cet ouvrage est bien antérieur et s’inscrit dans la continuité de mes recherches sur les discriminations (sexisme, homophobie, racisme, etc.). Il correspond également à la demande récurrente - lors de formations, de conférences et de débats auxquels je participe - d’un tel livre sur ces questions. Il tombe donc à point nommé et le chapitre sur les (més)usages du genre permet ainsi de montrer que ce dernier n’est ni une idéologie ni une théorie, mais un concept et un domaine de recherches qui se basent sur différentes disciplines et s’ancrent dans des terrains variés. Il y a donc une méconnaissance et une instrumentalisation du genre qui créent de la confusion et alimente des polémiques infondées. La constellation de clés d’interprétation que j’ai voulue interdisciplinaire peut constituer un outil novateur dans cette urgence de comprendre (pour reprendre l’intitulé de la série dans laquelle cet ouvrage est publié) qui passe notamment par un mouvement de clarification et d’historicisation.
Justement comment expliquez-vous que le genre cristallise peurs, rancœurs et autres fantasmes dans de nombreux pays ?
Lorsque des pas s’effectuent vers l’égalité, il est récurrent de constater des formes de résistances, qui brandissent comme un blason la naturalisation des rapports de pouvoir. Or, les normes ne sont ni naturelles, ni divines, ni universelles, ni atemporelles. Bien au contraire, elles sont le produit de décisions sociales, culturellement et historiquement situées. La construction sociale qui catégorise et hiérarchise ce qui est considéré comme masculin ou féminin dans une époque et un contexte donnés que révèle et relève le genre est perçue comme un danger par les garants (religieux, politiques, etc.) des inégalités. En effet, la mise en débat de ces questions dans l’espace public reflète l’histoire en mouvement. Comme les normes ne sont pas gravées dans le marbre, nous pouvons donc participer à leur (ré)élaboration vers le respect des droits humains et c’est précisément contre cela que ces gens s’insurgent. Il devient de plus en plus intenable pour eux de continuer à justifier que certaines femmes ne bénéficient pas du même traitement salarial que des hommes pour un travail équivalent et à compétences égales ; qu’un homme n’est pas fait pour aller chercher son enfant à la crèche ; que tout-e citoyen-ne a les mêmes devoirs mais n’a pas les mêmes droits quand il s’agit de pouvoir choisir de se marier. Concernant ce sujet, bien des individus commencent leur argumentation par : «Je ne suis pas homophobe mais…», alors qu’il s’agit bien de continuer d’assigner les personnes concernées dans la dévalorisation et la discrimination, de reconduire la hiérarchisation non seulement entre les sexualités mais aussi entre les sexes. D’ailleurs, ce que scandent - plus ou moins en filigrane - les slogans de ces manifs anti, c’est que le destin d’une femme revient à enfanter et rester confinée dans l’espace dit privé. C’est donc la mise à jour et au jour dans l’espace public des failles et de la non-naturalité de cette matrice hétérosexiste qui effraie les personnes qui l’incarnent, accrochées à leurs stéréotypes.
Pourquoi la Suisse ne connaît-elle pas selon vous les mêmes mobilisations de masse autour du genre ?
N’oublions pas que le calendrier politique helvétique voit se succéder - avec des titres plus trompeurs les uns que les autres et une récurrence de la manipulation d’arguments fiscaux - une initiative voulant renvoyer les femmes au foyer, des attaques contre les avancements relatifs à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) puis à l’éducation sexuelle, ainsi qu’une votation qui inscrirait dans la Constitution suisse que le mariage est l’union durable entre un homme et une femme. La visibilisation accrue de ces questions sur la place publique est intimement liée à la définition des contours de ce qu’est aujourd’hui un couple, une famille ou une nation (et, partant, de ce qui est considéré comme étranger à cette dernière). La façon dont elles sont appréhendées, discutées, mobilisées et médiatisées varie ainsi d’un contexte à un autre, sans oublier la crise en toile de fond. Du train de l’égalité en Espagne aux jeux olympiques de Sotchi, nous assistons à une reconduction et à un déploiement de l’économie et de la cartographie des questions de sexe, de genre et de sexualité. C’est pour cette raison que j’ai problématisé ces trois notions, tout en montrant que cette triade s’inscrit dans une mosaïque plus générale.
Comment a émergé cette idée de hacker le sexisme ?
Je tenais justement à illustrer l’idée selon laquelle les facettes du sexisme ne sont pas des éléments isolés mais qu’elles se fondent sur une architecture ; qu’il ne suffit donc pas de s’attaquer aux symptômes mais aux racines qui les (re)produisent. Mon objectif consistait à proposer à la fois des pistes de décryptage et de démantèlement. J’ai ainsi traduit cette idée de loupe d’analyse et de levier d’action à travers la métaphore d’un verbe, celui de hacker, dont la définition basique renvoie au fait de comprendre le fonctionnement d’un mécanisme dans le but de le détourner, de trouver les failles d’un système pour le déjouer tout en évitant de le consolider. Cette deuxième acception me permet de mettre en évidence les écueils à éviter et qu’il ne s’agit pas uniquement d’infiltrer ou de détourner un système mais surtout de créer des propositions en dehors de ce dernier. Comme "hacker" émane du champ informatique, il permet aussi d’interroger le rôle et l’emploi des nouvelles technologies dans les mobilisations actuelles. Je dépasse rapidement son contexte d’émergence pour l’utiliser comme une analogie. Il s’agit en effet d’une action de tous les jours que chaque personne met en œuvre à sa façon, de manière individuelle comme collective, sous des formes associatives ou artistiques par exemple. Comme l’indique le titre de ma conclusion, il est donc nécessaire d’avancer sur tous les fronts.
Votre travail sur les discriminations ne s’arrête donc pas à l’étude de leurs mécanismes ?
Si dans un premier temps je questionne la manière dont des catégories sont créées et des frontières tracées à des fins de domination, je me penche également sur les expériences des personnes qui éprouvent ces phénomènes de stéréotypage et de stigmatisation. En quoi la construction identitaire et la socialisation s’en trouvent-elles affectées ? A qui les personnes, et de surcroît les jeunes, peuvent-elles parler et s’identifier ? Quelles ressources existent pour colmater les fissures provoquées par la crainte ou le choc répété de l’injure ? Comme cette dernière n’est que la pointe d’un spectre de violences aux couleurs plus ou moins explicites et que les réponses se déclinent en fonction des individus et des groupes, j’articule en permanence les singularités des vécus et la transversalité des mécanismes de rejet. Il s’agit donc de contrer non seulement la production des inégalités mais également l’arsenal actuel des arguments fallacieux qui tentent de les justifier.
Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ?
Un des paradoxes saillants est le suivant : être pour l’égalité, mais contre le genre. Or, la concrétisation de l’égalité et la lutte contre les discriminations ne peuvent pas se réaliser sans un travail de fond et sans la prise en compte des questions de genre. Sinon, c’est juste une égalité cosmétique et de surface. Les enjeux ne sont pas uniquement politiques et scientifiques. La stratégie d’invasion de l’éducation et de la formation (passant par exemple du retrait de quelques enfants de certaines classes à la censure de ressources pédagogiques déconstruisant les stéréotypes - polémique autour de l'ABCD de l'égalité en France, ndlr) n’est pas anodine. Si ces sphères participent encore à la fabrique du genre, elles sont cependant censées être des espaces de réflexion et d’apprentissage, de construction de soi et d’autonomisation à travers la découverte de nouveaux horizons. Ces aspects renvoient du coup à une interrogation plus générale sur les sociétés qui se prétendent démocratiques : tendent-elles vers le maintien d’un ordre social inégalitaire ou vers la participation collective à davantage de justice sociale ?
Caroline Dayer, Sous les pavés, le genre. Hacker le sexisme, éditions de l'Aube, 92p.
Vernissage le 8 mars à 18h au café-librairie Livresse (rue Vignier 5, Genève)
Signature au salon du livre genevois puis en Suisse romande, à Besançon, Lille, Paris…