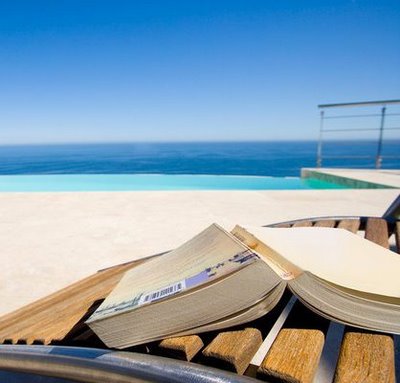Assignée garçon

Sophie Labelle est une blogueuse, bédéiste, militante féministe, trans, écologiste et indépendantiste québécoise. Auteure des livres Une Fille comme les autres et Le Comité infernal des ordres ténébreux, du blog www.lesbebespigeons.com, de la BD en ligne assigneegarcon.tumblr.com et coordonnatrice du Camp des Six Couleurs (un camp de vacances pour enfants intersexes, transgenres et non-conformes dans le genre), elle nous parle de ses engagements sans détour. Interview.
l'émiliE: Pourriez-vous nous dire quelques mots de votre parcours?
Sophie Labelle: J’ai étudié en littérature avant de m’intéresser à l’éducation, après un long voyage au Yukon (territoire fédéral du Nord du Canada, ndlr) où je travaillais dans une école primaire. C’est là que j’ai pris conscience du manque flagrant de ressources et de soutien pour les élèves transgenres, intersexes ou non-conformes dans le genre, et c’est ce qui m’a poussée à m’engager et à publier plusieurs livres s’adressant (surtout) à ces enfants. Ayant été assignée garçon à la naissance et ayant vécu plusieurs préjudices et discriminations sur la base de cette assignation, particulièrement en contexte scolaire, la visibilité et l’inclusion des enfants trans, intersexes et non-conformes dans le genre m’apparaît cruciale, de même que l’adoption d’un discours positif envers les différents parcours, expériences et corps de ces enfants.
Mon expérience de mésassignation s’inscrit dans mon militantisme féministe, la perte des privilèges associés à mon genre ayant catalysé en moi une indignation profonde envers le sexisme institutionnel. Avant cela, j’ai également milité pour l’indépendance du Québec et pour l’écologie, deux causes qui me tiennent encore à coeur et qui sont intrinsèquement reliées à mon engagement féministe.
Comment vous est venue l’idée de votre webcomic Assignée garçon ?
C’est partie d’une nécessité, celle de créer, en français, une histoire qui ne soit ni pathologisante ni oppressante à propos d’un personnage trans. Le média utilisé (la BD en ligne) a été choisi en fonction de la diffusion qu’il permet, en plus de générer un intérêt non-éphémère et réparti dans le temps.
Les ressources et l’information relatives aux enjeux trans étant d’une grande rareté en français, il m’importait de faire quelque chose qui soit concis et accessible. L’expérience de mon blog sur le genre et l’éducation («Les Bébés pigeons») m’a fait voir la nécessité de produire un contenu plus léger.
Aussi, le désir de retourner à mon média de prédilection, soit la bande dessinée, après une incursion dans le roman jeunesse avec Le comité infernal des ordres ténébreux, est ce qui a influencé ce choix en particulier.
Pourquoi ce titre Assignée garçon ?
C’est une question très pertinente ! Présentement, au Québec, d’importantes discussions ont cours dans plusieurs communautés trans en ce qui a trait au vocabulaire et à la terminologie qui traduiraient de la manière la plus inclusive et positive possible les expérience et les identités des personnes trans. Le choix de ce titre n’est pas étranger à ces discussions.
La définition la plus largement acceptée de «personne trans» est la suivante : «individu s’identifiant à un genre autre que celui assigné à la naissance». Suivant cette définition qui semble faire consensus, les personnes identifiées comme trans ne sont pas nécessairement «trans» de manière intrinsèque et innée, puisqu’à l’origine de cette expérience, il y a la mésassignation de genre - le fait d’avoir été assigné du «mauvais genre». Ce que cela signifie concrètement, dans le discours social sur les personnes trans, c’est qu’il faut changer de paradigme et cesser de problématiser, à travers les pratiques discursives et éducatives, le corps des personnes trans pour plutôt problématiser le regard et les pratiques coercitives qui forcent les enfants à se conformer aux attentes sociales envers leur genre assigné à la naissance.
Dans cette optique, il m’apparaissait important de problématiser d’abord le fait que Stéphie ait été assignée garçon à la naissance, plutôt que de chercher à décrire le personnage comme vivant une expérience trans.
Stéphie, l’enfant trans*, s’exprime comme un adulte et d’ailleurs dans une des planches, sa mère vérifie son âge. C’est voulu?
Absolument ! À travers mon engagement avec les enfants transgenres, j’ai été à même de constater à quel point celles-ci et ceux-ci vivent une multitude de micro-agressions quotidiennes, en plus de subir les affres d’un discours social très négatif envers leur corps : «né-e dans un corps de fille ou de garçon», «né-e dans le mauvais corps», «prisonnier d’un corps de fille ou de garçon»… Si on y ajoute la pression immense qu’on fait peser sur les enfants pour qu’ils se conforment aux stéréotypes de genre, il me fallait une championne de la rhétorique pour mettre à jour ce discours !
Vous remettez en cause la croyance pour les personnes trans* d’être nées dans le mauvais corps ?
Premièrement, dans tous les cas, je ne crois pas qu’il puisse vraiment s’agir d’une «croyance» à proprement parler, puisque les personnes trans qui utilisent cette expression pour décrire leur expérience l’utilisent comme une métaphore d’un sentiment légitime, et il ne s’agit donc pas d’une croyance au sens où l’on pourrait débattre de la véracité de ce sentiment.
Deuxièmement, il faut comprendre qu’il s’agit d’une expression chargée de négation envers le corps des personnes trans, en plus de nier l’identité propre de la personne. Car si on concède, par exemple, que les hommes trans (assignés filles à la naissance) sont effectivement des hommes et que leur corps leur appartient, eh bien ce corps sera subséquemment un corps d’homme, pas un corps de femme ! Cette question touche précisément l’effet de désincarnation qu’induit une telle expression, ainsi qu’un des enjeux majeurs des luttes pour les droits des personnes trans et intersexes : la réappropriation de leur corps.
Enfin, bien que je m’oppose fermement à l’utilisation de formules de ce genre pour décrire «l’expérience trans» en général, je peux aisément concevoir qu’un individu, pour une raison ou une autre, considère que cette image lui convient pour décrire ce qu’il vit. Toutefois, l’imposer à toutes les communautés trans indistinctement m’apparaît très maladroit.
Dans votre blog, l’éducation occupe une place centrale. Tout se joue au berceau ?
Je dirais plutôt qu’au berceau, tout est déjà joué ! Sans blague, l’idée n’est pas de jouer à la biologiste ou à la sociologue (ou au psychologue s’improvisant l’un des deux) ici, mais bien d’énoncer la simple existence d’enfants transgenres, intersexes et non-conformes dans le genre. De là le titre : vous avez sûrement déjà vu un pigeon ? Eh bien, avez-vous déjà vu un bébé pigeon ? Non ? Pourtant, ils existent, et comme ces enfants, ils sont simplement invisibles si on ne les cherche pas.
Comme ces enfants sont rendus invisibles (je parle beaucoup du processus «d’invisibilisation» dans mon blog [et au Québec, nous aimons inventer des mots, en témoigne la graphie de «blogue» qu’impose l’Office de la langue québécoise !]) la première et la plus urgente tâche, tant en éducation que dans la société, n’est pas tant de déterminer si leur existence découle d’une donnée biologique ou d’un construit social, mais bien de reconnaître leur présence et de leur donner la place qui leur convient, ce qui est loin d’être acquis, tant en France qu’au Québec.
Étant du milieu de l’éducation (je travaille et étudie au département des Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal), je peux témoigner à quel point de simples pratiques de gestion de classe peuvent rendre invisibles et illégitimes les identités, les corps et les expériences de plusieurs enfants, ce qui constitue en soi une agression.
Vous dénoncez l’autrisme en tant que catégorie, pourquoi ? Et pourquoi pas les catégories LGBTQI ?
L’autrisme n’est pas une catégorie, mais bien un processus social qui rend les groupes minoritaires (ou dominés) illégitimes ou invalidés. Le fait de «rendre autre» est ce qui classifie, qui crée des catégories distinctes afin de mieux gérer ces groupes minoritaires. Ainsi, les minorités de genre ou d’orientation sexuelle ou les groupes racisés se voient constitués en des entités d’une classe à part, ce qui permet de les tenir à distance du pouvoir et des privilèges de la majorité ou des groupes dominants.
Quant aux communautés LGBTQI, je me figure mal comment elles pourraient soudainement obtenir suffisamment de privilèges au détriment de la majorité hétérosexuelle, blanche, cisnormative et non-intersexe pour réussir à la rendre «autre»!
Quelles solutions préconisez-vous alors pour visibiliser les groupes minoritaires?
Le premier pas, selon moi, consiste en l’adoption d’un discours inclusif et positif envers eux. Le fait de dire que les filles naissent avec une vulve et les garçons avec un pénis est éminemment invisibilisant pour les enfants trans et d’autant plus douloureux pour les enfants intersexués. Inclure les enfants qui ne s’identifient pas nécessairement comme fille ou comme garçon ou encore les enfants en questionnement passe par la simple reconnaissance, au jour le jour, du fait qu’il n’existe pas que des filles ou des garçons dans la société.
On me passe souvent la remarque, dans le milieu de l’éducation, que malgré le fait qu’on soit ouvert, s’il n’y a pas d’enfants trans, intersexe ou non-conforme dans le genre dans la classe, nul besoin d’adapter notre pratique pour elles et eux. C’est faux ! Comme je le mentionnais, ces enfants sont invisibles. Ce n’est que lorsqu’on leur fait une place d’emblée qu’elles et ils la prennent.
J’ai été témoin d’une scène parlante à ce sujet. Un collègue avait demandé de faire deux rangs en prévision d’un déplacement : un rang de fille et un rang de garçon. J’ai saisi l’occasion pour ajouter qu’il y avait un troisième rang, «pour tous les autres». Eh bien deux enfants ont décidé d’intégrer le troisième rang. C’est ça, selon moi, «rendre visible» !
Vous évoquez la transpanic des médias canadiens. Qu’est-ce que c’est?
La transpanic [panique trans, à défaut d’une expression plus appropriée] définit une réaction déraisonnée d’un individu, d’un groupe d’individus ou, dans ce cas-ci, des médias devant des personnes trans ou des enjeux spécifiques aux communautés trans. Le mot est calqué du terme anglais homosexual panic, qui sert à légitimer certains actes autrement répréhensibles sous le prétexte d’une panique pathologique envers les personnes homosexuelles ou trans.
Lorsqu’on parle de transpanic des médias, on évoque la couverture médiatique disproportionnée et irréfléchie de certains évènements. Je pense, par exemple, à la couverture de l’expulsion d’une jeune fille trans néo-écossaise de son école secondaire parce qu’elle désirait utiliser les toilettes des filles, ou à celle de ces parents ontariens qui ont décidé de ne pas assigner de genre à un de leur enfant...
Vous vous opposez aux lieux ségrégués. Vous militez pour la mixité absolue?
Lieux ségrégués n’est pas synonyme de non-mixité : il y a, dans la ségrégation, un pouvoir coercitif qui oblige des individus à fréquenter tel ou tel lieu, tandis que dans la non-mixité, il y a une notion de réappropriation du lieu par le groupe, ce qui peut s’avérer nécessaire dans certains cas.
Lorsque je parle de lieux ségrégués, c’est toujours par rapport aux écoles, mais ça pourrait évidemment s’appliquer à d’autres sphères de la vie publique. Le fait est que les lieux ségrégués le sont souvent en fonction du genre assigné à la naissance (et non du «sexe», comme on voudrait bien le croire : sinon, on verrait des toilettes pour les personnes intersexes depuis longtemps...). Ainsi, ces lieux sont potentiellement très dangereux ou non-sécuritaires pour les enfants trans ou non-conformes dans le genre, alors qu’il suffirait d’un tout petit effort pour rendre ces lieux plus inclusifs. J’offre plusieurs exemples d’initiatives sur mon blog.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le Camp des Six Couleurs?
Il s’agit d’une colonie de vacances pour les enfants transgenres, intersexes et non-conformes dans le genre, dont la première édition a eu lieu en août dernier au Québec. La création d’un espace sécuritaire et inclusif pour ces enfants s’avère essentiel à leur socialisation ; aussi, c’est une occasion unique pour elles et eux de rencontrer d’autres jeunes vivant des expériences similaires à la leur. Les colonies de vacances «traditionnelles» étant des lieux qui peuvent s’avérer très anxiogènes pour ces enfants, le Camp des Six Couleurs vient pallier un manque flagrant!
Photo © Valérie Lessard