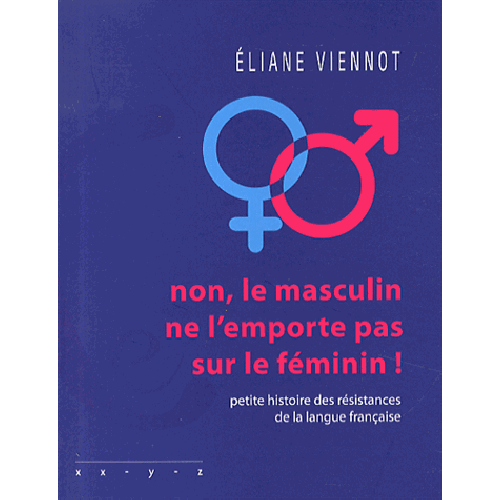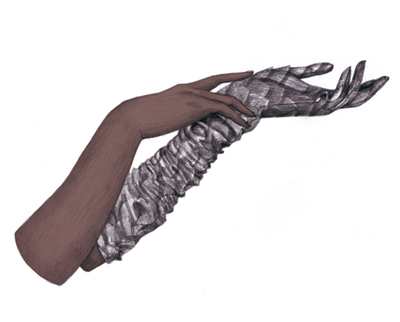La cuisine n’est pas épargnée par le sexisme. Du contenu de nos assiettes à la répartition inégale des tâches culinaires, des stéréotypes sexistes jusqu’aux rôles différenciés dans les métiers de bouche, les fourneaux méritent un bon coup de torchon ! La cuisine est souvent une histoire de traditions : le lapin à la bière de Mamie, la crème anglaise de l’oncle Georges, le riz au poisson de la cousine Khady... On l’aime, on la déteste, on la délègue ; elle est un passe-temps ou une corvée. Une chose est sûre : elle est aussi une affaire de rôles et de liens sociaux. Par conséquent, truffée d’inégalités. axelle magazine a mis les pieds dans le plat.
Décortiquer la mère nourricière
Au quotidien, nombreuses sont les femmes à porter sur leurs épaules le poids des représentations sexistes. Parce qu’elles sont femmes, elles posséderaient le sens inné du service aux autres et de la cuisine altruiste. Aussi actives soient-elles sur les plans privé et professionnel, les femmes passent toujours deux fois plus de temps aux fourneaux que les hommes : six heures par semaine, contre deux heures trente pour les messieurs. La cuisine serait-elle toujours un grand livre de recettes au goût patriarcal ?
Selon Patricia Mélotte, doctorante en psychologie sociale et spécialiste de la question du genre (ULB), "d’une part, la société assigne aux femmes les tâches ménagères et les soins des enfants. Elles sont élevées dans ce sens. D’autre part, on attend d’elles qu’elles y montrent plus d’intérêt que les hommes. Le tout est intériorisé, de l’ordre de l’implicite."
D’après Dominique, 55 ans, "il y a une différence entre cuisiner et nourrir. Cuisiner avec un grand "C", c’est du plaisir, du bonheur. Nourrir avec un petit "n", c’est de l’ordre des obligations." Sabine, 42 ans, confie : "J’adore cuisiner mais à un moment, j’en ai eu assez d’entendre tous les jours, aux mêmes heures, le "Maman, on mange quoi ?", le "Chérie, tu as acheté quoi pour le souper ?" Je travaille à temps plein, je m’occupe seule des enfants et en plus, je suis responsable du bien-être de l’estomac de chacun. Je n’ai pas le droit d’être fatiguée. Un jour, j’ai explosé et j’ai décidé d’aller voir une psychologue pour m’aider. Je culpabilisais énormément d’avoir cette remise en question. J’avais l’impression d’être une mauvaise épouse, une méchante mère." Les rappels à l’ordre, directement énoncés ou sous-jacents, culpabilisent les femmes lorsqu’elles sortent des rôles imposés par la société. En cuisine et ailleurs.
Réduire le super-héros
La réalité n’est pas aussi acide pour toutes les femmes. Des couples mettent en place des stratégies pour réduire le poids des tâches quotidiennes. "Mon conjoint cuisine et moi, je m’occupe de la maison. Ça s’est fait un peu naturellement en fonction des goûts et des capacités de chacun", explique Marie, 30 ans. Mais dans les faits, le partage égalitaire ne serait pas si équitable car la charge du travail invisible, c’est-à-dire l’organisation mentale du foyer, est souvent assumée par un seul membre du couple, majoritairement la femme. "Elsa cuisine car elle aime ça et personnellement, j’en suis incapable. Elle me fait même des boîtes Tupperware pour les jours où elle finit tard. Mais la gestion quotidienne, c’est pour moi : la liste des courses, l’organisation du lave-vaisselle, le paiement des factures, aller conduire et rechercher notre fils à la crèche…", confie Stéphanie, 33 ans.
Caricaturons un peu : lorsque dans un couple, Monsieur cuisine, il se voit attribuer toutes les caractéristiques du super-héros. Il a confectionné une tarte aux oignons ? On l’applaudit. Une purée de carottes pour les enfants ? On l’acclame. Et aux reines de l’organisation vont les miettes de sa gloire… Ainsi que l’explique Patricia Mélotte, "quand les hommes se mettent à la tâche, ils sont souvent perçus comme des héros des temps modernes. Ils sont généralement davantage récompensés car ils sortent, au regard de la société, de ce qu’ils savent faire : investir la sphère publique et ramener de l’argent au sein du foyer." La chercheuse tient à préciser : "Les hommes qui s’investissent dans les tâches quotidiennes éprouvent aussi une forme de pression de la société. Ils culpabilisent à l’idée d’abandonner leurs prescrits d’hommes. On attend d’eux qu’ils soient plus investis professionnellement que les femmes." Comment dépasser les vieux clichés qui s’accrochent à notre épluche-légumes ? "On y arriverait vraiment en éduquant les enfants différemment pour que leur processus d’identification se fasse en voyant un papa et une maman se partager les tâches", plaide Patricia Mélotte. Le partage des tâches, et la gestion mentale du foyer…
Ficeler la notion de prestige
Inégalités aux fourneaux, sexisme dans les petits plats ! Au cours de l’édition française 2014 de l’émission Top Chef, les membres du jury – une femme pour quatre hommes – ne peuvent parfois pas s’empêcher de souligner le caractère "féminin" des assiettes de certaines candidates, un adjectif qui définirait plutôt les crudités que la charcuterie. En réalité, ce qui se cache derrière la soi-disant "féminité" d’un plat ne dépend pas du sexe de la cuisinière, mais de rôles sexués : aux femmes, la cuisine domestique, pragmatique, à l’abri du foyer ; aux hommes, le prestige de la gastronomie, de la technique culinaire, de la visibilité publique. "C’est vrai que mon homme a davantage tendance à sortir le grand jeu et à cuisiner quand on a des invités. On a l’impression que c’est Noël", ironise Christelle, 29 ans. "Les hommes ont investi l’univers de la gastronomie parce que c’était en dehors de la sphère domestique, donc non féminin, plus prestigieux", explique Patricia Mélotte.
S’il existe des cheffes reconnues, la bataille, pour elles, commence souvent dès l’école. "Pendant mes études, on avait tendance à considérer que les filles étaient plus fragiles, qu’elles géraient moins bien le stress en cuisine et qu’elles étaient, par nature, incapables de porter des casseroles lourdes. D’ailleurs, elles sont nombreuses à avoir choisi la salle et non la cuisine comme finalité", confie Olivier, 41 ans, professionnel dans la restauration. Les femmes cantonnées à leur rôle de serveuses, celles qui prennent soin des autres ? Aurore (nom d’emprunt), commise de cuisine dans un grand restaurant : "Je crois que la réalité est bien plus complexe. Ce serait réducteur de penser que toutes les femmes sont en salle. Dans certains établissements de standing, c’est même plutôt l’inverse. On a tendance à faire davantage confiance aux hommes pour le contact avec la clientèle. Une seule femme pourrait s’occuper des clients : celle du patron."
Caraméliser le postulat du physique parfait
Une autre réalité colle au secteur de la restauration : les femmes seraient un outil marketing. Ingrid (nom d’emprunt), serveuse dans un bar, le confirme : "J’ai été recrutée sur la base de mon physique. D’ailleurs, mon employeur ne sélectionne que des femmes pour le service. Notre physique met de l’argent dans les caisses." Et les femmes instrumentalisées pour appâter le client ont plutôt intérêt à rentrer dans le corset de la taille 38 !
"La cuisine pour moi, ce sont mes éternels problèmes de poids", témoigne Caro, 35 ans. Anorexie, boulimie, grossophobie : la société dicte aux femmes ce qu’elles doivent mettre dans leur assiette (attention aux calories !), en quelle quantité (peu, surtout pas entre les repas) et avec quelles manières (le dos droit et la cuillère légère).
Résumons : les femmes ont encore aujourd’hui la responsabilité des estomacs familiaux. Mais quand elles veulent enfiler la toque de cheffe, on les retoque. Par ailleurs, leurs corps sont jugés, pesés et auscultés, ce qui les culpabilise d’aimer la bonne chère. Et puis quoi encore ?
Évider le sacrifice et les interdits
Quand la précarité nous tenaille, quand on a sous-estimé les quantités achetées ou que surgit une petite voix intérieure nous susurrant que nos proches n’ont pas eu assez, on se sacrifie. La fourchette pique, le couteau tranche, le bras se tend vers l’assiette de l’autre, l’enfant, l’invité. Comme si la capacité à partager ses protéines ne se conjuguait qu’au féminin ! L’anthropologue française Françoise Héritier l’explique clairement. Dès la Préhistoire, les femmes furent soumises à "un modèle archaïque dominant de pensée". Parce que leur corps était différent, les femmes furent catégorisées, confinées au sein de la sphère domestique, au service de la procréation et de la pérennité du groupe. Nourrir le clan par le fruit de leur cueillette, oui. Chasser, non : l’activité est technique, extérieure, virile, masculine (et lorsqu’on trouve des preuves de la participation des femmes à la chasse, on les passe facilement au presse-purée de l’Histoire).
En termes d’alimentation, Françoise Héritier le souligne : les femmes ont toujours été sujettes à des interdits. "Notamment dans les périodes où elles auraient eu besoin d'avoir un surplus de protéines, car enceintes ou allaitantes – je pense à l'Inde, à des sociétés africaines ou amérindiennes. Elles [les femmes] puisent donc énormément dans leur organisme sans que cela soit compensé par une nourriture convenable ; les produits "bons", la viande, le gras, etc., étant réservés prioritairement aux hommes. Ce n'est pas tant éloigné que cela de nos manières hexagonales : dans les années 40, dans ma famille paysanne auvergnate, les femmes ne s'asseyaient pas à table, mais elles servaient les hommes et mangeaient ce qui restait. Cette "pression de sélection" qui dure vraisemblablement depuis l'apparition de Néandertal, il y a 750 000 ans, a entraîné des transformations physiques. A découlé de cela le fait de privilégier les hommes grands et les femmes petites pour arriver à ces écarts de taille et de corpulence, entre hommes et femmes." Au royaume de la nourriture différenciée, l’assiette des femmes ne compterait donc que trop peu de protéines et de calcium…
Cette inégalité dans l’accès aux nutriments est intégrée culturellement et symboliquement : on attend d’une femme qu’elle grignote gentiment les carottes crues que requiert l’entretien de sa taille menue, et non pas qu’elle dévore à pleines dents un rôti-mayonnaise arrosé d’un demi-litre de bière (en particulier si elle est jugée "grosse", auquel cas elle est supposée faire régime). Tout cela laisse le goût amer d’une société encore trop peu égalitaire !
Illustration © Aline Rolis pour axelle magazine