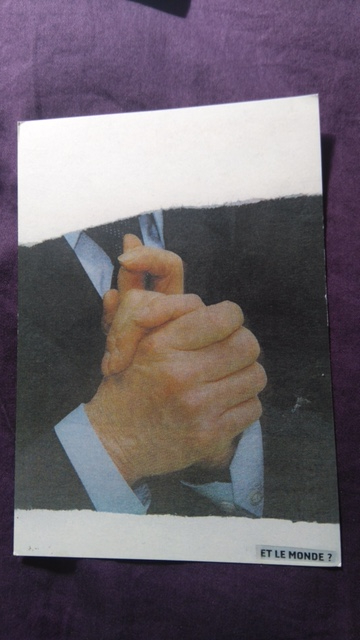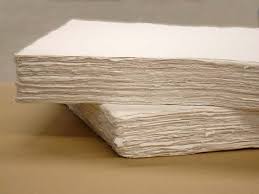ÑANDÚ

Nous quittons la côte de l'Atlantique sud pour nous enfoncer à l'intérieur des terres et dans l'histoire du continent. Finies les plages touristiques arpentées par les Argentin-e-s et Brésilen-ne-s, villégiatures des généraux de la dictature uruguayenne quelques années plus tôt. Nous découvrons les grands espaces (tous clôturés sans exception) dédiés à l'élevage : des milliers de vaches sur des miliiers d'hectares, mêlées aux chevaux, aux moutons et, plus sauvages, aux ibis garde-boeufs et aux ñandús.
Les ñandús ressemblent à de petites autruches. J'ai appris leur nom en cherchant dans les étoiles du ciel la constellation de la "Croix du Sud", avec un nouvel ami de rencontre, Javier. Certains de ses ancêtres sont indiens et il m'explique que la constellation que je cherche, invisible depuis l'hémisphère nord comme la Grande Ourse est invisible pour lui au Sud, n'est pas une "croix" mais, selon les légendes indiennes, un "pied de ñandú". Javier raconte encore que la légende prophétise que les Indiens doivent prendre garde, car leur avenir suivrait celui des ñandús : l'extinction.
Officiellement, l'Uruguay ne compte aujourd'hui parmi ses habitant-e-s aucun-e indigène, aucun-e descendant-e des populations autochtones pourtant nombreuses lors de l'arrivée des premiers colons espagnols. Au XIXe siècle, le génocide entamé dès les débuts de la conquête 300 ans plus tôt, a été achevé avec l'objectif d'éradiquer, jusqu'au dernier, les Indiens encore réfugiés au nord de l'Uruguay et dans la Patagonie argentine, parce qu'ils perturbaient les plans de progression des grandes propriétés d'élevage.
Je lis Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, et alors que nous passons non loin des Mines de Oro abandonados, je me plonge dans les récit d'horreur des mines d'argent de Potosi (Haut Pérou) et des mines d'or d'Ouro Preto (Brésil). "En trois siècles, la riche Potosi anéantit huit millions de vies humaines. Les Indiens étaient arrachés aux communautés agricoles et acheminés, avec leurs femmes et leurs enfants, vers la colline. Sept sur dix de ceux qui partaient n'en revenaient jamais. Les Espagnols exploraient des centaines de milles à la ronde, à la recherche de main-d'oeuvre. Beaucoup d'Indiens moururent en chemin avant d'atteindre Potosi. Mais c'était les terribles conditions de travail qui tuaient le plus. (...) Six mille cinq cents brasiers brûlaient la nuit sur les flancs de la riche colline. À cause de la fumée des fours, il n'y avait ni pâturages ni récoltes dans un rayon de six lieues à la ronde et les émanations n'étaient pas moins implacables pour les corps des hommes."
Concernant l'extraction intensive de l'or, les Indiens ayant été exterminés dans le siècle précédent, "elle accrut non seulement l'importation d'esclaves mais elle vida d'une bonne partie de la main-d'oeuvre noire les plantations de canne à sucre et de tabac des autres régions du Brésil. (...) La soif d'esclaves de Ouro Petro était insatiable. Les noirs mourraient rapidement ; rares étaient ceux qui supportaient sept années continues de travail."
Ces descriptions préfigurent le pillage du continent sud et centre-américain jusqu'à nos jours, pillage qui prendra selon les régions et les époques le visage de l'exploitation du cuivre, du mercure, de l'étain, du caoutchouc, du pétrole mais aussi des monocultures de sucre, de café, de cacao, de tabac, de coton ou encore de bananes...
Sur notre route, nous passons près du village de Núñez, électrifié il y a tout juste trois semaines... pour permettre l'extraction du pétrole. Puis nous entendons parler des mines plus au sud de Santa Clara de Olimar, et des nouveaux projets du président Mujica de mines à ciel ouvert. J'entends parler de mouvements de protestation contre ces projets miniers et espère glaner quelques tracts ou faire des rencontre pour comprendre les raisons de cette colère.
Nous allons au musée de l'indio a Tacuarembo... où les vestiges du peuple charrúas se résument à peau de chagrin. Nous sommes chez Santiago et nous discutons politique. Soudain, il nous propose de le suivre à la réunion d'un collectif indigéniste, qui se déroule discrètement dans un garage d'une maison particulière. Certains participants ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour être là. Nous sommes une quinzaine, la discussion (fort animée) porte sur la pertinence de la "declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas".
En discutant plus tard dans la soirée avec Santiago, je réalise que "Tupamaros" vient de Tupac Amaru, nom du très connu cacique métis, descendant direct des empereurs incas et qui pris la tête d'un mouvement messianique et révolutionnaire de grande envergure contre les Espagnols et l'horreur de Potosi. En 1781, il assiégeait Cusco, ayant rallié à lui des miliiers d'autochtones, avant d'être finalement trahi, capturé et supplicié, avec sa famille et ses principaux partisans.
Et de me demander à quel point ce mouvement révolutionnaire des années 60-70, issu de luttes paysannes et étudiantes, s'est appuyé sur cette sourde mémoire des massacres et du pillage colon pour refuser le capitalisme dépendant qu'il avait produit...
- Catégorie parente: Rubriques spéciales
- Affichages : 14806